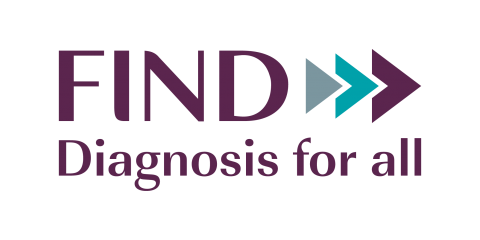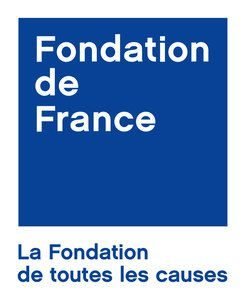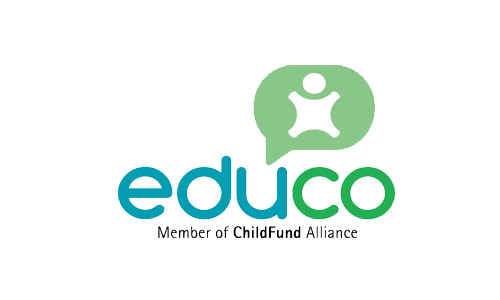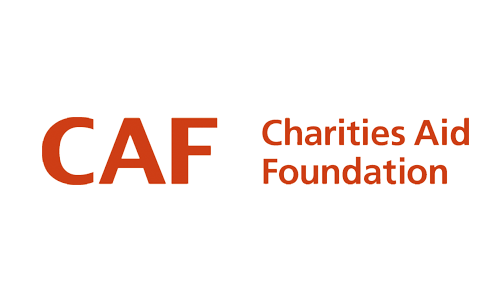L'accès aux droits et santé sexuels et reproductifs est un droit fondamental
Si des progrès ont été réalisés, avec notamment une baisse de 45% de la mortalité maternelle entre 1990 et 2015, les engagements en faveur des droits et de la santé sexuels et reproductifs restent très insuffisants au niveau mondial. Chaque jour, 800 femmes meurent de causes évitables liées aux complications dues à la grossesse et à l'accouchement et, chaque année, on dénombre 225 millions de femmes qui souhaitent éviter une grossesse mais n'ont pas accès à une contraception sûre et efficace, entraînant 80 millions de grossesses non désirées à travers le monde et 22 millions d'avortements pratiqués dans de mauvaises conditions.
La santé sexuelle et reproductive est un concept englobant, qui comprend aussi bien la santé en matière de sexualité et de procréation que la santé maternelle et néonatale. Elle implique le respect des droits sexuels et reproductifs de chacune et chacun : le droit de mener une vie sexuelle sûre et librement choisie, le droit d'avoir accès à une offre de services de planification familiale complète, ou encore le droit de vivre à l'abri des violences sexuelles et dans le respect de son intégrité corporelle.
En Afrique de l’Ouest et Centrale, les indicateurs de droits et santé sexuels et reproductifs restent préoccupants. Les problèmes de santé liés à la santé sexuelle et reproductive représentent ainsi une problématique importante de par leur prévalence. Les jeunes et les adolescentes d'Afrique de l'Ouest et centrale sont particulièrement concernées : seules 14,7 % des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans mariées ou en union, ou leur partenaire sexuel, utilisent actuellement au moins un moyen de contraception, la région présente la proportion la plus élevée d'adolescentes donnant naissance avant l'âge de 18 ans (33 %). Un accès des adolescentes aux moyens de contraception permettrait d'éviter 2.7 millions de grossesses non consenties par an en Afrique subsaharienne, selon une étude de Sex Rights Africa Network.
Positionnement et actions de Solthis pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive
Afin de répondre aux besoins des populations en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR), notamment les plus vulnérables et les plus marginalisées (personnes vivant avec le VIH, les travailleur·euse·s du sexe, ou les personnes LGBT+), Solthis met en œuvre des interventions qui permettent, d'une part, de renforcer l'exercice de leurs droits sexuels et reproductifs et d'autre part d'améliorer l'accès à des services de SSR complets et de qualité.
L'organisation reconnaît l'importance d'une approche globale et intégrée afin d'accompagner les individus dans leur vie sexuelle et reproductive tout au long de leur vie, chaque service de SSR faisant partie d'un ensemble de composantes interconnectées en ciblant particulièrement les priorités suivantes :
- éducation sexuelle complète ;
- conseils et services de contraception ;
- prévention et prise en charge des IST/VIH ;
- prévention, dépistage et prise en charge du cancer du col de l'utérus ;
- prévention, dépistage et prise en charge des violences basées sur le genre ;
- renforcement de la prise en charge des publics jeunes et adolescents et prise en compte des
besoins spécifiques des personnes en situation de vulnérabilité ; - intégration des services de SSR et de VIH ;
- soins complets d'avortement.
- et au niveau des soins de santé primaires :
- prévention de la transmission du VIH mère–enfant ;
- soins prénataux ;
- soins obstétricaux et néonataux d'urgence ;
- soins postnataux ;
- référencement vers les structures adaptées.
→ Découvrez le positionnement de Solthis en matière de DSSR.
→ En savoir plus sur nos projets et résultats